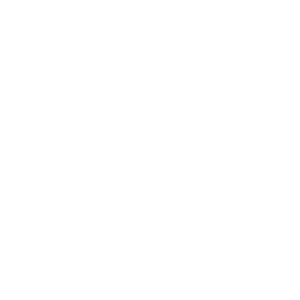TBS accueillait le 26 septembre une conférence sur le risque de voir surgir, dans les prochaines années, une nouvelle crise économique, et sur les moyens mis en place par les autorités pour s’en protéger.
Le capitalisme sans les crises, c’est comme une religion sans les péchés : ça n’existe pas. » Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cet aphorisme n’est ni de Karl Marx, ni de Jean-Luc Mélenchon… mais d’Ivan Odonnat. Directeur adjoint de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France, à Paris, l’homme était venu le 26 septembre à la Toulouse Business School (TBS) pour une conférence intitulée « quels sont les risques d’une nouvelle crise financière ? » Et disons-le tout net : en accord avec la maxime précitée, ils sont grands. Voire, incontournables. Aussi, le conférencier avait-il été invité, comme l’a résumé le directeur de la Banque de France d’Occitanie Stéphane Latouche, à venir expliquer, dans le contexte d’un krach annoncé pour bientôt – entre 2020 et 2021 – « ce qu’il y a de vrai et de faux » dans cette prédiction, « comment nous avons avancé depuis la précédente crise de 2008 et si notre système financier est plus résilient aujourd’hui ».
Pour commencer, « l’environnement n’est pas très positif », reconnaît l’économiste, qui cite parmi les principaux facteurs de risque « la croissance mondiale encore languissante, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, le Brexit », et même les Gilets jaunes… Surtout, « l’affaiblissement des taux d’intérêt » qui, devenus négatifs, exacerbent les risques auxquels sont exposées les institutions financières sur le marché des obligations secondaires – là où vendeurs et acheteurs s’échangent les titres de créances contractées, par exemple, par les ménages ou les entreprises. De plus, en 2018, l’endettement du secteur privé non-financier en France a atteint 132 % du PIB – soit une hausse de 45 points depuis la fin 2000 ! Ce qui fait dire à Ivan Odonnat qu’en dépit de la baisse des taux d’intérêt, « et parce que les entreprises s’endettent plus, on a un coût du service de la dette qui augmente ». Concernant les ménages, s’ils bénéficient en France de taux fixes, qui les protègent en cas de remontée des taux d’intérêt, et que leur emprunt est solidement garanti par des cautions et des hypothèques, « on peut avoir une inquiétude quant au taux d’effort – c’est-à-dire la difficulté à rembourser – qui va croissant » ; une situation qui, hélas, « n’est pas unique en Europe » ni dans le monde.
De manière plus générale – et peu surprenante – un grand risque vient, comme toujours, « des marchés financiers, comme les marchés d’actions et obligataire, car les institutions financières, banques et assureurs français, ont dans leurs bilans des actifs qui sont valorisés sur ces marchés. Or, quand on regarde le prix de ces actifs, on constate qu’ils sont à un niveau historiquement élevé. De sorte qu’on peut se demander si cela représente la vraie valeur de ces entreprises, ou si elles évaluent correctement le risque de l’émetteur quand il s’agit d’obligations ». Aussi, pour Ivan Odonnat, « le sentiment qu’on peut avoir, c’est qu’on est peut-être en dehors des valeurs qu’on devrait observer dans la prise de risque, et il peut y avoir des accidents qui entraînent une correction à la baisse » de la valeur des actifs. Phénomène qui arrive régulièrement, y compris depuis deux ans, même si à ce moment-là, « on ne s’en est pas vraiment aperçu car ces épisodes n’ont pas duré ».
D’un autre côté, la faiblesse des taux d’intérêt a entraîné un recul de la marge nette d’intérêt bancaire, et une baisse de la rentabilité des portefeuilles financiers dans l’assurance-vie qui oblige les assureurs à puiser dans leurs réserves pour assurer leurs promesses de retour sur investissement. Assis aux côtés de l’économiste de la Banque de France, le président du directoire de la banque Courtois, Hervé Rogeau, rappelle en outre que « les prévisionnistes annoncent que ces taux négatifs sont là pour longtemps » – au moins quatre ou cinq ans – « donc c’est tout un pan de l’activité des banques qui est en train de disparaître ».
Pour autant, la baisse des marges est partiellement compensée par un faible coût du risque dans les portefeuilles de crédit, puisque jusqu’ici, ménages et entreprises se portent (encore assez) bien. Cependant, chose curieuse, « le régulateur bancaire, dans sa grande sagesse, nous met parfois dans une position schizophrénique », ironise Hervé Rogeau : « comme le risque baisse, il considère que notre matelas de provisions doit baisser », là où, pour le dirigeant, les banques devraient au contraire augmenter leurs fonds en prévision d’une éventuelle remontée du risque de défaillance. « Mais nous n’avons pas actuellement la possibilité de provisionner, c’est pourquoi nous profitons de ce coût du risque-là pour avoir une rentabilité un peu meilleure et servir les fonds propres que nous demande d’avoir le régulateur ».
En particulier, ceux prévus par les accords dits de Bâle II, un dispositif prudentiel qui oblige les banques à entretenir un ratio minimum de fonds propres lorsqu’elles prêtent de l’argent. Or, « les pays anglo-saxons, les États-Unis en tête, sont en train de diminuer les obligations réglementaires des banques alors que nous arrivons à la fin d’un cycle positif ». Une tendance qui ne date pas d’hier puisque, comme le souligne Jean- François Verdié, professeur à TBS, « hors zone euro, tout le monde n’est pas aussi fair-play que les Européens qui ont beaucoup transposé les règles de Bâle II ». Dans le collimateur : les États-Unis, mais aussi la Chine, dont « la manière avec laquelle le risque est évalué dans leurs banques » laisse l’enseignant pour le moins songeur…
UN SYSTÈME PLUS RÉSILIENT… EN THÉORIE
Pour autant, en Europe, Ivan Odonnat affirme que les enseignements de la crise de 2008 ont été tirés, au point que « le système financier est suffisamment robuste pour résister ». Mieux, les superviseurs français et étrangers seraient désormais plus attentifs ; de même qu’il y a eu, de la part des banques, « une augmentation des dispositifs de conformité, avec des structures de gestion du risque dans tous les grands établissements financiers ». Chaque année, la Banque de France organise de plus une réunion « où l’on passe en revue les réformes qui ont été faites, et la façon dont elles ont été mises en œuvre. On constate aujourd’hui que les banques françaises, en général, ont doublé leurs ratios de capitaux bancaires par rapport à 2008 : elles ont donc suffisamment de liquidités pour faire face à leurs engagements » même si, reconnaît Ivan Odonnat, « elles ne sont pas toutes au seuil requis, certaines étant encore en train de constituer » ces réserves. Également au registre des bonnes nouvelles, malgré « les facteurs de risque qui viennent rogner sur la profitabilité des banques, globalement, celle-ci augmente » grâce à d’autres activités comme la distribution de produits d’assurance ou la gestion de portefeuilles, ce que « la Banque de France considère comme un facteur de résilience ».
Autre mesure de protection héritée de la précédente crise économique, « la communauté financière en Europe a mis en place des mécanismes qui permettent, lorsqu’un grand établissement est en difficulté, de le traiter de façon ad hoc, et de s’assurer qu’il a dans son bilan les ressources suffisantes pour financer soit la reprise de ses activités, soit la mise en faillite sans solliciter le contribuable », au contraire de ce qui s’est passé en 2008. D’où pour Ivan Odonnat, l’importance de « faire passer le message que nous avons aujourd’hui des dispositifs qui permettent d’éviter cela… en théorie. On les a constitués, mais on ne les pas encore testés : [il faudra] voir s’ils fonctionnent ». Tout comme, en théorie, les marchés dérivés seraient désormais plus sûrs « avec des opérations de reporting obligatoires » ; même si, reconnaît-il, « tant qu’on ne l’a pas testé, on n’est pas sûr que tout cela fonctionne correctement ». Encourageant.