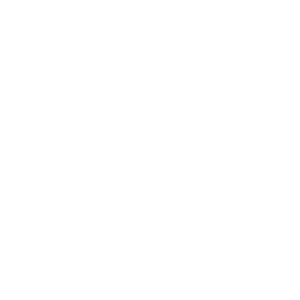Spécialiste de l’économie de l’environnement à TSE, il se penche sur les moteurs de l’innovation à destination
écologique et de la transition énergétique pour les entreprises.
Au bord du canal de Brienne, le nouveau bâtiment de la Toulouse School of Economics (TSE), est encore en chantier. Qu’importe, Stefan Ambec accueille néanmoins dans son bureau du troisième étage, dont la large baie vitrée offre la vision, non loin de là, de la Manufacture des tabacs, bâtiment historique de l’école qui deviendra, en 2021, le nouveau lieu d’accueil de Sciences-Po. Les chercheurs en économie auront-ils gagné au change ? Seul l’avenir le dira. En attendant, malgré les bruits incessants du chantier et les odeurs de peinture, Stefan Ambec ne laisse rien paraître d’une gêne éventuelle. Mais fait preuve d’une faconde naturelle dès lors qu’on le questionne sur son sujet de prédilection – l’analyse économique des politiques environnementales – bien plus que sur lui- même, ou sa personnalité. Affable mais pudique, l’homme évite de s’attarder sur les questions personnelles ; tout juste saura-t-on que le presque quinquagénaire a grandi à Fraisse-sur-Agout, un village niché dans le parc naturel régional du Languedoc entre Castres et Béziers. À l’époque, ses parents sont agriculteurs ; puis ils divorcent. Son père part en banlieue parisienne, où Stefan Ambec passera plusieurs années ; sa mère, suédoise, repart, elle, à Göteborg. La ville côtière, presque au centre d’un triangle nordique unissant Oslo, Stockholm et Copenhague, n’a pas un attrait uniquement touristique, mais aussi universitaire.
Fait amusant, le chercheur de TSE travaille justement en ce moment sur un article scientifique avec une collègue de l’université de Göteborg, consacré à « la régulation des émissions d’oxyde d’azote par les usines et les centrales thermiques » en Suède. « L’oxyde d’azote est un gaz qui détériore la qualité de l’air, à l’impact très local – autour de la zone d’émission – mais qui voyage aussi un petit peu, au-delà des frontières. Pour prendre en compte ces deux impacts, local et global, poursuit l’économiste, il était important d’avoir un instrument de mesure. Or, il se trouve qu’en Suède, il y a une taxe sur les émissions et, pour chaque département, des standards d’émission pour chaque industrie. Donc, nous essayons de voir comment le standard peut être adapté dans le temps, à l’environnement économique, en prenant en compte la taxe ». Plus précisément, les deux chercheurs s’intéressent à la façon dont l’entreprise va réagir à la taxe, « sachant que son choix de technologie ou d’émission donne une information sur ses coûts pour réduire les émissions. Une information qui peut être utilisée par le régulateur local, au niveau du département, pour fixer le montant du standard écologique ». Et ce, en ayant à l’esprit de trouver le « juste équilibre » entre l’amélioration de la qualité de l’air et une activité économique viable… tant pour le bien-être des entreprises que pour les consommateurs, « car en Suède, il y a beaucoup de chauffage collectif grâce à la biomasse, qui produit beaucoup d’oxyde d’azote. C’est pourquoi il faut arriver à maintenir l’activité à un certain niveau tout en améliorant la qualité de l’air ; c’est une question d’activité, mais aussi de coût, car cela suppose d’installer des filtres, mais le régulateur ne connaît pas ces coûts pour l’entreprise. Or, la taxe permet de révéler une partie de ces coûts, en montrant comment l’entreprise adapte ses émissions au standard », ce qui permet ensuite éventuellement d’adapter ce dernier.
« Ce qui est intéressant avec ces données, c’est que deux instruments sont utilisés – la taxe et le standard – pour un seul polluant. Si vous avez un problème de pollution de l’air, le standard est pratique, car il permet de ne pas dépasser un certain seuil, alors que la taxe ne permet pas de le garantir, observe Stefan Ambec. Donc, pour étudier les émissions de particules fines ou d’azote, c’est un bon instrument ; en revanche, le standard ne permet pas d’apprendre ce qu’a fait l’entreprise : on observe juste qu’elle le respecte, alors qu’avec une taxe, on peut mesurer à quel point elle a réduit ses émissions. Elle nous apprend combien cela coûte à l’entreprise de réduire ses émissions ».
Quant à savoir si Stefan Ambec est plutôt optimiste ou pessimiste sur le futur de notre environnement… En vrai scientifique, celui-ci fait « l’hypothèse qu’il y a une volonté dans la société de faire cette transition vers un modèle économique plus propre. Je vois des choses qui me permettent de voir qu’on va peut-être y arriver, et des choses qui ne marcheront clairement pas ! Il y a des mauvaises idées, même si c’est difficile de trouver des exemples, car il y a toujours des arguments pour et contre ». Pour autant, l’économiste prévient : arriver à une transition, « ça va coûter cher ! » D’où un certain dilemme – dont on serait bien en peine de trouver aujourd’hui le début d’une solution : « comment faire en sorte d’y arriver à un rythme régulier et soutenu, de façon efficace, à moindre coût, tout en protégeant les plus pauvres ? » Sur ce dernier point, reconnaît-il, difficile en effet « de convaincre, en particulier les pays en voie de développement et qui sont assis sur des tas de charbon, de ne pas l’utiliser pour aller vers la transition énergétique et les mobilités douces ! » Cependant, pour Stefan Ambec, « la clé, c’est l’innovation: car la transition, ce n’est pas seulement réduire nos émissions, c’est aussi favoriser la R&D, le déploiement de technologies décarbonées. Ce qu’on a commencé à faire avec les énergies renouvelables, et que l’on va poursuivre avec les voitures électriques. C’est d’ailleurs un autre sujet sur lequel je travaille : l’intermittence des énergies renouvelables, comment les gérer avec les batteries… Mais même s’il va falloir progresser sérieusement sur cette question, l’avantage de ces technologies est qu’elles pourront être transférées aux pays en voie de développement. Même s’il faudra leur vendre ! Du coup, le coût de cette technologie devra être compétitif. Ce qui demandera bien sûr de trouver des moyens de la rendre compétitive… » Certes, l’éolien et le solaire commencent à l’être, « mais il y a le problème de l’intermittence : pas de soleil la nuit, ou pas de vent aux moments où la population a besoin d’énergie… C’est vrai que pour l’instant, cela va être difficile, surtout pour fournir l’industrie, et que cela va demander beaucoup d’investissement. Pour l’instant, tout se fait à petite échelle, y compris en France, même si la pénétration du renouvelable est de plus en plus importante ! » S’il est une chose en tout cas certaine, c’est que Stefan Ambec – tout discret qu’il soit sur ses motivations profondes – a un réel intérêt pour les questions sociales. À l’en croire, son choix de devenir économiste aurait ainsi été guidé par son intérêt tant « pour les mathématiques que les questions sociales », puisque l’économie, explique-t-il, utilise les premières pour répondre aux secondes. Après son bac C au lycée de Béziers, le voilà donc qui s’inscrit à l’université Toulouse 1 Capitole pour une licence, puis une maîtrise d’économétrie. En 1993, ayant envie de changer d’air, il part pour une année d’échange à Montréal… L’étudiant d’alors se plaît au Québec, « d’autant qu’à l’époque, il y avait un bon département d’économie. Ça s’est un peu dégradé depuis ! » L’économiste dit avoir apprécié aussi « ce rapport plus facile avec les professeurs, à l’américaine : on peut les rencontrer facilement, on les tutoie ». Au final, Stefan Ambec restera cinq ans dans la Belle Province, entrecoupés – service militaire oblige – d’un an et demi en coopération au Sénégal, à l’Office de recherche et techniques des sciences d’outre-mer (Orstom, aujourd’hui l’Institut de recherche pour le développement) de Dakar. L’occasion d’appliquer pour de bon l’économie à une question hautement sociale : le partage des fleuves et rivières entre les pays. Revenu passer sa thèse au Québec en 1999, l’économiste y fera encore un post-doc, puis repartira pour un second à l’université de Salerno (près de Naples), avant d’atterrir à l’Inra de Grenoble. Il y passera six ans, avant de rejoindre Toulouse en 2007 ; expérience pendant laquelle il travaillera notamment sur « l’hypothèse de Porter », du nom de l’économiste américain Michael E. Porter, qui postule que « sous certaines conditions, la régulation environnementale peut être profitable à l’entreprise car cela la force à innover, et que le bénéfice de cette innovation compense son coût. Ce qui ne se vérifie… pas toujours ! Ce qu’on peut montrer, c’est que souvent, les politiques environnementales favorisent l’innovation, mais le fait que ce soit profitable se vérifie très peu. Donc, vous voyez, je ne suis pas si optimiste que ça ! » Et nous donc…