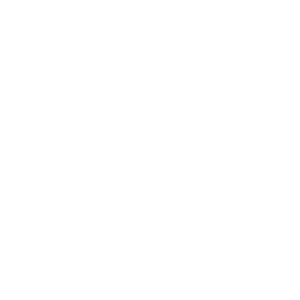À l’occasion de la sortie de son livre Les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier, entretien avec Jacques de Larosière, ancien président du FMI et ex-gouverneur de la Banque de France.
Vous remettez en cause l’analyse keynésienne, tout en recommandant de s’appuyer dessus pour relancer l’économie…
« Si je peux me permettre, je n’ai pas mis en cause l’analyse keynésienne. Au contraire, j’ai montré qu’elle a apporté un souffle nouveau à l’économie. La stimulation de la demande interne a été très positive. Ce que je remets en question, c’est l’usage, depuis Keynes, qui s’est établi : à savoir, faire durer la stimulation. Keynes était un économiste qui voulait lutter contre les baisses de conjoncture, mais pas de manière pérenne. Après la stimulation, on s’arrêtait, puis le cycle économique reprenait. Ce que je conteste, c’est de faire cela tout le temps, parce que si vous faites cela, vous avez un problème d’endettement. Keynes était très prudent sur l’endettement public ; il était très conservateur. Pas de prélèvement obligatoire au-dessus de 25 % du PIB. Or, on est à 45 %, donc très loin de Keynes. Je suis un keynésien, mais qui suit Keynes ».
Le marché n’est pas raisonnable. Le politique doit-il reprendre un rôle d’arbitre plus prononcé ?
« Keynes était méfiant envers les marchés : beaucoup de keynésiens devraient relire cette phrase : « Lorsque l’organisation des marchés financiers se développe, l’activité de spéculer l’emporte sur l’activité d’entreprendre ». Elle est rarement citée : le marché a pris une dimension exacerbée depuis 30 à 40 ans. Les “croyants” en la valeur du marché ont fini par établir deux présupposés erronés : premièrement, le développement et l’intégration des marchés sont favorables à la croissance économique, ce qui n’est pas démontré ; deuxièmement, les marchés se corrigent eux-mêmes quand ils dévient des fondamentaux. On a vu que cela n’avait pas du tout été le cas avec la crise de 2008. J’ai une certaine méfiance envers les marchés et je pense qu’on leur a trop lâché la bride depuis une quarantaine d’années ».
La problématique de la dette est au cœur de vos analyses. Pourtant, on y a toujours eu recours pour créer de la valeur. Pourquoi s’en méfier aujourd’hui ?
« Au-delà d’un certain niveau, la dette devient un facteur de moindre croissance parce qu’elle génère des intérêts et une charge qui réduit la capacité à créer de la richesse. Nous avons malheureusement dépassé ce point (100 % du PIB en dette publique) et je signale les inconvénients de cette situation. Même avec des taux d’intérêt très bas, la dette nous coûte très cher. Son service représente le second budget de la nation. C’est plus de 2 points de PIB. Les pays qui ont eu une autre politique que la nôtre (comme l’Allemagne) ont des performances supérieures aux nôtres en termes de croissance et d’emploi. Il ne faut pas s’obstiner dans une médication qui est dangereuse pour le corps social. Les gouvernements empruntent sur les marchés, c’est le plus facile. Depuis l’effondrement du système de Bretton Woods (taux fixe entre les monnaies), on est entrés dans une économie d’endettement à croissance très rapide. L’observation économique montre que le multiplicateur keynésien est moins efficace quand il y a trop de dette. Celle-ci génère une incertitude et un manque de confiance. Des études sont en cours qui montrent les limites du multiplicateur en fonction de l’endettement qui prévaut ».
Et pour les entreprises ?
« La dette privée a aussi fortement augmenté. Une grande partie de l’endettement public se fait par le biais d’obligations. C’est inquiétant car c’est générateur de crises. Si le cycle économique ralentit, le poids de la dette provoque la crise. Des crises surviennent parce que certaines entreprises ne peuvent plus payer et entraînent les banques qui leur ont prêté. C’est assez sérieux car, depuis la crise de 2007-2008, l’endettement global du monde a augmenté ; on n’a donc pas tiré les leçons de la crise. Nous sommes aujourd’hui, en France, les champions de la dette privée ».
16 000 milliards remis au pot par l’Europe et les États-Unis après la crise de 2008 : c’est énorme. Existe-t-il un bouton « reset” sur certains niveaux d’endettement ?
«Il y a des cas où il n’y a pas d’autres moyens que de restructurer la dette. C’est arrivé : le Venezuela, l’Argentine ; ça a failli être le cas de la Grèce. On arrive à des arrangements entre créanciers et débiteurs. La stratégie de la dette que j’ai développée, c’est que les efforts devaient être partagés entre créanciers et débiteurs. Il y a eu des exemples célèbres avec la France révolutionnaire et ses assignats. Bonaparte, lors du Directoire, a œuvré pour le « tiers consolidé », à savoir que les deux tiers de la dette seraient perdus. Mais dénoncer la parole donnée rend les créanciers très méfiants… S’ils prêtent à nouveau, c’est à des taux supérieurs. C’est une arme à double tranchant.
Si on s’endette à tort et à travers, et que l’on croit que ce n’est pas un problème, on se trompe parce qu’on transfère sur les générations futures des problèmes. La dette devient trop lourde et la croissance décroît. C’est une attitude anti-sociale : les futures générations n’ont pas choisi cela. On décide pour eux que notre train de vie actuel est plus important que le leur. Cette dette sert en fait à payer les fins de mois et part dans la consommation. Si encore ces emprunts servaient à l’investissement productif…
Ma réflexion est aussi de caractère politique. La démocratie, c’est en grande partie la possibilité pour les citoyens de déterminer à travers leurs élus les grandes orientations qu’on devrait leur soumettre. Depuis 50 ans, c’est un déni. Les élus ne font pas leur travail stratégique. On accumule la dette. Et un beau jour, les problèmes vous éclatent à la figure. C’est ce qui se passe aujourd’hui. Prendre des décisions, ce n’est pas se cacher derrière la dette. Sinon, la génération à venir n’aura pas les bénéfices de la démocratie ! Si les choix politiques disparaissent, il n’y a plus de démocratie. Les générations passeront leur temps à être écrasées par notre dette ou à la renégocier ».
Vous êtes pour le référendum d’initiative citoyenne (RIC) des Gilets jaunes alors ?
«Je ne sais pas si je suis pour le RIC… Les dérives que je décris dans ce livre ont été avalisées, acceptées, tolérées par les élus et les gouvernants de la République pendant 50 ans. Y a-t-il eu une seule fois un débat à l’Assemblée nationale ? Jamais sur les grandes orientations. C’est un défaut de la démocratie ».
Les élites sont-elles le problème ?
« Oui, en partie. Les élites ont contribué objectivement à ce que les vrais problèmes ne soient pas posés et que tout soit noyé sous les vannes du crédit et de l’endettement. C’est une politique que je conteste. Les événements que nous vivons devraient nous inviter à réfléchir sur cette absence de débat ».
Comment rattraper la situation, sachant que les Français ne veulent pas travailler plus ?
« C’est le langage que j’entends depuis 50 ans. Il y a le responsable politique qui ne souhaite pas être confronté à des réformes de structures (comme celle du départ de l’âge à la retraite). Ce n’est pas une attitude de chef d’État. Il y a une autre attitude, celle des gouvernants responsables : « Je ne suis pas élu pour être réélu, mais pour améliorer le bien-être national ». Alcide De Gasperi disait : il y a deux catégories d’hommes politiques. Ceux qui ont un horizon à cinq ans pour leur réélection et ceux qui ont une vision à une génération pour le bien-être national.
Il est vrai que les gens préfèrent souvent la facilité à l’effort. Les élus ont poussé à cela. Mais la vérité finit toujours par vous rattraper. C’est maintenant le cas. Trop de dépenses publiques, trop de prélèvements obligatoires : 46 % en France quand la moyenne européenneestà37%. Il y a un ras-le-bol fiscal, c’est ce que disent les Gilets jaunes. Je suis même étonné que ces réactions n’aient pas eu lieu plus tôt. Ça nous invite à nous pencher sur la pression fiscale. Ce n’est pas facile, mais le peuple français est intelligent. Si on lui explique, il comprend.
En outre, on peut diminuer la dépense publique sans sabrer dans le social. Plusieurs pistes existent. La première, c’est de repousser l’âge du départ à la retraite. Si nous ne touchons pas à la limite des 62 ans – alors qu’elle est de 65 ans, voire 67 ans, partout ailleurs en Europe – nous devrons diminuer les retraites, et je vous souhaite bien du courage… Nous devons accepter l’idée de travailler trois ans de plus : c’est une idée prosociale qui éviterait les conflits intergénérationnels. Un autre gisement d’économies réside dans la rationalisation des échelons de l’administration territoriale, qui se sont multipliés et qui entraînent des dépenses considérables ».
L’Italie se met en marge des observations budgétaires que l’Europe lui adresse depuis l’installation de son nouveau gouvernement dit « populiste”. Qu’en pensez-vous ?
« L’Italie a fait un redressement remarquable en termes de dépenses publiques. Ce pays a un excédent primaire : quand vous défalquez les taux d’intérêt, vous voyez qu’ils ont un sur-plus important qui va déterminer le profil futur de la dette italienne. La France n’est pas capable d’avoir un surplus primaire. Donc, en tendance, la dette italienne plafonne (ou diminue légèrement) alors que la nôtre augmente ».
Un rééquilibrage de la répartition de la valeur ajoutée entre capital et force de travail pourrait-il être un levier?
« On ne peut pas être égalitaires. Il y a des gens qui réussissent mieux que d’autres. Le capital est indispensable car il sert à l’investissement. En revanche, il faut veiller à ce que l’inégalitarisme inhérent à la condition humaine ne soit pas tel qu’il amène un nombre important de personnes dans la pauvreté. Si on détache une fraction substantielle de la classe moyenne vers la pauvreté, alors on crée un malaise social qui se manifestera inévitablement parce que les gens sont anxieux. Non seulement parce qu’ils tombent dans la pauvreté, mais parce que leurs enfants risquent d’y naître. Même si la situation s’est dégradée, la société française reste moins inégalitaire que les pays anglo-saxons, grâce notamment à la répartition par l’impôt sur le revenu que la moitié des foyers fiscaux ne paient pas ».
Certes, mais tout le monde paie la TVA…
« C’est exact. Il faut se poser la question des droits indirects et donc de la TVA. L’impôt indirect représente près d’un tiers de la masse fiscale totale. Ce tiers est inégalitaire par définition. Ceux qui ont des revenus très faibles paient en proportion plus que ceux qui ont des revenus importants. Est-ce que le mix d’un impôt direct et un impôt indirect est correct ? Je ne sais pas, je ne suis pas fiscaliste. En tout cas, il en va de la cohérence sociale. Y réfléchir, c’est un des aspects positifs qui peut naître de ce mouvement ».