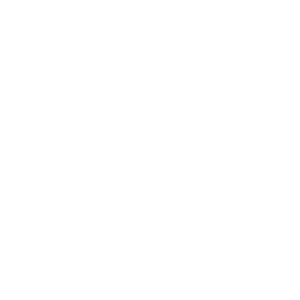L ’une des ordonnances publiées au Journal officiel du 23 septembre 2017 fixe le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s’impose au juge.
Ce barème s’applique aux contentieux consécutifs à des licenciements prononcés postérieurement au 23 septembre 2017.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le salarié ou l’employeur refuse une réintégration dans l’entreprise, le juge accorde au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les planchers et plafonds fixés par les nouvelles dispositions du code du travail en la matière. Ces dispositions avaient déjà été prévues par la première loi Macron d’août 2016, mais retoquées par le Conseil constitutionnel.
Ce qui a pu être qualifié de passage en force par l’exécutif, imposant une mesure largement favorable à l’employeur, n’a pas résisté au pouvoir d’interprétation des conseillers prud’homaux. En effet, depuis plusieurs mois, on constate que les conseils de prud’hommes écartent un à un ces dispositions impératives et attribuent aux salariés des indemnités supérieures aux plafonds susvisés.
Après plusieurs conseils de prud’hommes de province, c’est au tour du conseil de prud’hommes de Paris de résister et d’écarter le désormais fameux « barème Macron ». Dans un jugement du 22 novembre 2018 notifié aux parties le 1er mars 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, a en effet décidé de motiver sa décision fondant l’octroi des dommages et intérêts sur l’article 24 de la Charte sociale européenne et l’article 10 de la convention OIT.
Par principe, le conseil de prud’hommes précise haut et fort et d’une manière courte mais sans ambiguïté qu’il octroie des dommages et intérêts en refusant d’appliquer le barème et en estimant qu’une réparation adéquate est due au salarié.
La résistance des conseils de prud’hommes continue et continuera sans aucun doute malgré la tentative d’intimidation de la ministre de la Justice qui n’a pas hésité à donner des instructions aux procureurs de la République de France et de Navarre afin que ces derniers soient présents aux audiences où il est question du plafonnement et aussi afin qu’on lui fasse remonter toutes les décisions relatives à cette question.
Cette immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire est incontestablement contraire au principe de la séparation des pouvoirs et démontre à tout le moins l’impuissance de ce premier à faire appliquer une mesure contestée depuis son origine.
Cette « jurisprudence » s’étend et commence à inquiéter sérieusement le gouvernement. Au point que le directeur des affaires civiles et du Sceau a adressé une circulaire à tous les procureurs généraux des cours d’appel – pratique rarissime sur une question de droit du travail – pour leur demander de recenser les décisions rendues sur la question de la conformité du barème à ces conventions internationales et de prendre la parole devant les cours d’appel, lorsqu’elles seront saisies de cette question.
Il est également regrettable qu’elle n’ait pas sollicité, en même temps que les décisions du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, celle du Comité européen des droits sociaux (« Finnish Society of Social Rights c. Finlande »), qui a déjà désavoué un barème similaire. Tout comme il est dommage que la circulaire ne s’explique pas davantage sur la portée plus que limitée des décisions qu’elle invoque, et n’ait pas précisé, notamment, que le Conseil constitutionnel n’est pas juge de la conformité des lois aux conventions internationales, et que la décision du Conseil d’État sur ce point est une décision de référé, sans autorité de chose jugée, qui ne lie en rien les juges judiciaires. Mais nul doute que les parquets généraux le savent et qu’ils pourront rappeler ces principes lorsqu’ils concluront librement sur ces affaires.