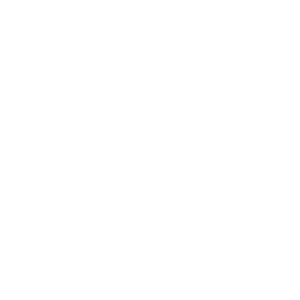Economiste à TSE, cette pétillante quadragénaire doit à son enfance passée à Castelnaudary son goût pour les questions liées à l’agriculture et à l’industrie agroalimentaire, dont elle décortique le fonctionnement depuis 20 ans.
Comme bon nombre de mères de famille, ce qui énerve souvent Zohra Bouamra-Mechemache, ce sont « ces pubs pour des céréales pleines de sucre qu’on passe aux heures des dessins animés préférés des enfants… Ça me met hors de moi ! Clairement la pub, et en particulier celle qui vise les enfants, est là pour changer le comportement alimentaire des enfants, alors qu’on sait justement que les bonnes habitudes se prennent dès le plus jeune âge », déplore cette mère de deux enfants. Laquelle est d’autant plus sensible à ces tentatives de manipulation qu’elle-même est une économiste spécialisée dans les questions d’agriculture et de l’industrie agroalimentaire.
« Ce qui m’intéresse, c’est de comprendre les liens entre les politiques publiques sur l’ensemble de la chaîne agroalimentaire, ainsi que son fonctionnement, l’impact qu’ont les différents acteurs sur les prix des marchés, pour les consommateurs comme pour les agriculteurs… », explique la pétillante quadragénaire dans son bureau de la Toulouse School of Economics (TSE), dans l’ancienne Manufacture des Tabacs. Plus précisément, ses travaux portent en ce moment « sur les relations entre l’industrie agroalimentaire et la grande distribution, sur les coopératives et les organisations de producteurs, bref : je bricole à l’intérieur de la chaîne ! », rigole-t-elle. Par exemple, l’un de ses articles scientifiques en préparation « consiste à mieux comprendre les stratégies des hard discounters dans leur choix de mettre en rayon, ou non, des marques nationales. Car en général, ceux-ci mettent plutôt des marques de distributeurs ; mais on constate de plus en plus qu’elles intègrent des marques nationales. Donc, on essaie de comprendre pourquoi elles le font, ainsi que l’impact que cela a dans la concurrence avec les supermarchés plus traditionnels, et les relations avec les producteurs des produits, notamment dans le prix de gros ». D’ordre plus théorique, un autre article sur lequel elle travaille porte « sur la qualité sanitaire des produits : nous essayons de voir quel serait le meilleur contrat » entre les intervenants de la filière agroalimentaire « pour avoir un produit qui réponde à des normes de qualité optimale ? L’idée de ce papier est de se demander si, par exemple, la coopérative peut jouer un rôle dans l’amélioration de la coordination entre producteurs et distributeurs, et donc dans la qualité du produit dans la chaîne ? L’idée est aussi de se dire qu’en passant directement par la coopérative, le distributeur y gagne certes, car il a moins de coûts de transactions » que s’il allait voir chaque agriculteur indépendamment. D’un autre côté, observe Zohra Bouamra-Mechemache, « la coopérative accepte toute la production des différents agriculteurs, donc il n’y a pas une motivation très forte de la part de ces derniers à respecter un cahier des charges élevé ; il y a même une incitation à tricher, puisque ce qu’ils produisent est de toute façon accepté. D’où la nécessité de trouver un contrat qui permette d’améliorer la production de chacun, afin que la qualité globale de ce qui est vendu au distributeur soit meilleure ».
Autre sujet de recherche, et qui révèle des résultats à rebours d’une certaine doxa politique, « la compétitivité à l’exportation des industries agroalimentaires en Europe. On voulait en particulier regarder au départ si, comme on le dit souvent, il y a un différentiel dû au coût du travail. Donc nous avons développé un petit modèle, avec lequel nous avons examiné ce critère, mais aussi la qualité des produits dans chaque secteur agroalimentaire, et les effets de frontière » – à savoir dans ce cas, puisque l’étude ne sort pas de l’espace Schengen, de la proximité ou de la différence culturelle d’un pays à un autre, qui favorisent ou freinent les échanges de produits alimentaires. Résultat de l’étude : contrairement à ce qui est souvent affirmé, « il y a effectivement un petit effet du coût du travail » dans les freins à l’export, « mais ce n’est pas le plus important. L’effet frontière est beaucoup, beaucoup plus important : en Europe, il y a plus d’échanges entre certains pays car ils sont plus proches culturellement. Donc, si on veut augmenter les exportations, il faut peut-être utiliser d’autres outils que le seul coût du travail… » Quant à savoir lesquels, « bonne question ! », éclate de rire la chercheuse. Bien sûr, tout d’abord, travailler sur « l’effet frontière, en faisant qu’il y ait moins d’écarts culturels, plutôt que d’insister sur la qualité du produit. On pourrait aussi mettre en place des incitations financières, s’interroger sur le fait de pousser à la création d’organisations de producteurs, etc. Mais tout dépend du sujet sur lequel on travaille ! D’abord parce que je ne suis pas “Madame Irma”, et parce que les décisions dépendent des questions que l’on se pose : il n’existe pas de solution-clé. Je pense que toutes ces études permettent de comprendre des mécanismes économiques, et avec cette compréhension, de prendre des décisions un peu plus éclairées. Mais déjà les comprendre, ce n’est déjà pas si simple ! »
D’autant qu’avec la recherche, on obtient souvent des résultats inattendus. Ainsi, il y a une dizaine d’années, l’économiste travaillait « sur les fromages AOC : je voulais voir si le fait d’avoir un tel label permettait d’être plus performant sur les marchés de l’agroalimentaire. Plus particulièrement, je mesurais cette performance en nombre d’années de survie sur le marché. J’avais tellement envie que cela soit vrai, que j’étais sûre que cela aurait un effet très important ! Et… même si on a trouvé qu’il y avait effectivement un effet positif, on s’est rendus compte que là aussi, ce n’était pas le critère le plus déterminant. Ce qui expliquait surtout la survie de l’entreprise, c’était beaucoup plus l’efficacité des technologies de production ! » Pour Zohra Bouamra-Mechemache, la science ne manque donc pas de surprises. Tout comme l’économie fut, pour elle, une découverte inattendue : « en fait, c’est par hasard que je suis devenue économiste », concède celle qui, enfant, se voyait « plutôt devenir maîtresse d’école, comme beaucoup de petites filles ! Pour le côté sérieux, et les connaissances qui me plaisaient ». Lisant beaucoup, aimant autant les cours de maths que de français, la jeune fille, qui a vécu à Castelnaudary jusqu’à l’obtention de son bac scientifique, ira ensuite en prépa HEC. « Puis je me suis rendu compte que HEC, ce n’était pas fait pour moi. Je ne me voyais pas dans ce milieu ; en plus, il fallait payer une école, alors que je suis issue d’un milieu très modeste. Donc, je suis allée à la fac, et grâce à une équivalence, je me suis retrouvée dans un IUP d’ingénierie économique, et puis j’ai continué. Ça m’a tout de suite plu, même si je ne savais pas du tout ce que c’était au départ ! », sourit Zohra Bouamra-Mechemache. Quant à savoir ce qui l’a poussée, dès sa thèse, à s’intéresser au monde agricole, l’explication est moins surprenante : Castelnaudary ! « J’ai toujours vécu entourée d’agriculteurs, j’ai travaillé dans les champs depuis mon adolescence jusqu’à ma vie de jeune adulte, donc ça faisait sens pour moi », explique la chercheuse. Laquelle ajoute presque aussitôt que ce qu’elle aime, « c’est de comprendre les choses, mais de manière qu’elles soient liées aux individus ; comprendre comment les gens fonctionnent en société, comment ils prennent leurs décisions. Et c’est pour ça, je crois, que je suis devenue économiste plutôt que chercheuse en informatique ou en physique ! ».