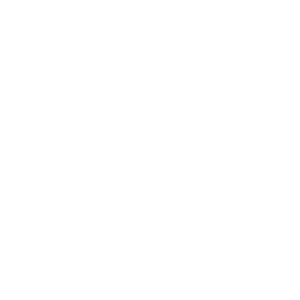Très occupée, la présidente de l’université Toulouse 1 Capitole tient néanmoins autant à continuer à enseigner – avec passion mais fermeté – qu’à faire de la recherche sur son sujet de prédilection : la délinquance d’affaires.
De son propre aveu, Corinne Mascala a un caractère « assez carré… J’aime les lignes droites ! », concède celle qui, depuis 2016, occupe le siège de présidente de l’université Toulouse 1 Capitole. Au lycée pourtant, la jeune Bordelaise se voyait enseigner plus tard l’anglais, ou la philosophie ; jusqu’à ce que son prof de philo lui déconseille « d’aller en fac de lettres, car il disait que ce n’était pas assez concret ou cadré pour mon caractère ». Et visiblement, l’enseignant n’était pas trop loin du compte car, comme le recon- naît sans détours Corinne Mascala, « j’avais déjà un sens assez développé de l’autorité de l’État, du service public, de la Justice. Donc, je me suis dit que le monde du droit correspondrait bien à mon idée de la hiérarchie ». Dès sa première année d’études à l’université de Bordeaux 1 (devenue depuis Bordeaux 4 Montesquieu), elle se sent attirée par le droit pénal et la magistrature, et plus particulièrement… le parquet. « Il y avait une autre possibilité, le droit des affaires, car je suis issue d’une famille de chefs d’entreprise » : à l’époque en effet, ses parents dirigent La pantouflerie de France, un fabricant familial d’abord de pantoufles puis de chaussures pour femme et enfant, créé par le grand-père de Corinne Mascala au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et qui emploiera jusqu’à 700 salariés… dont ses oncles, tantes et cousins. La jeune fille d’alors, pourtant, se refuse à entrer dans la société : « j’ai très vite pris conscience que cela allait devenir compliqué, car dans les années 1980, des concurrents sont arrivés : chinois, indiens, portugais… Toutes les grandes entreprises françaises ont mis la clé sous la porte, et notre activité s’est réduite ». Pas très engageant, donc ; d’autant qu’à la vingtaine, « j’avais envie de sortir du cocon familial ! ».
Donc, ce sera le droit. La juriste suit le cursus classique : maîtrise de droit privé, suivi de deux DEA (désormais master 2) en droit pénal et droit privé et d’un certificat en criminologie et sciences pénitentiaires. Surtout, dès la première année, c’est une révélation : « j’ai découvert l’enseignement ! Grâce à des profs qui m’ont marquée, je me suis dit que c’était ça, ce que je voudrais arriver à faire. Un objectif que j’ai poursuivi, et finalement atteint », se félicite Corinne Mascala. Laquelle estime n’avoir « aucun regret » de ne pas être devenue procureur de la République ou juriste d’entreprise, « car l’enseignement est, pour moi, une véritable passion. C’est pour cela que je ne pouvais pas être uniquement présidente d’université ! Alors certes, ça suppose d’avoir un emploi du temps très bien organisé… J’ai abandonné les cours en deuxième année, mais j’ai conservé mes cours en master, et j’assure toujours le cours de droit pénal des affaires en master 1 et 2. J’aime la transmission du savoir, la pédagogie, et la relation avec les étudiants. C’est un public extraordinaire ». Extraordinaire, vraiment ? À rebours des profs d’université qui sont nombreux, en France, à se plaindre d’une baisse générale du niveau culturel et orthographique de leurs étudiants, Corinne Mascala « n’accepte pas le discours actuel selon lequel l’étudiant d’aujourd’hui serait moins bon que celui d’hier. Ce n’est pas qu’il est moins bon, c’est qu’il n’est pas le même. Quand j’étais étudiante, on lisait beaucoup et on travaillait en bibliothèque », n’ayant pas, contrairement aux apprentis juristes d’aujourd’hui, la réponse disponible en un seul clic sur Google ou Wikipédia. Et quitte à surprendre, la présidente d’UT1 ajoute même que les étudiants de 2019 « sont toujours aussi volontaires, et ils sont beaucoup plus sérieux qu’on ne l’était, plus angoissés par l’avenir. Ils ne sont pas chahuteurs – en tout cas ici – et attendent beaucoup des enseignants ».
« En revanche, l’étudiant d’aujourd’hui n’a pas l’habitude de travailler – mais je dirais que c’est moins de sa faute que de celle du système éducatif. Parce que, depuis 30 ans, celui-ci a été moins exigeant avec l’étudiant quand il était au lycée, et l’a moins habitué à travailler par lui-même que par le passé ; du coup, quand ce dernier arrive à l’université, il y a un choc parfois violent… qui n’est pas facile à dépasser, et qui pour certains va être la cause de leur échec. Donc, ce qu’on essaie de faire comprendre aux étudiants, c’est que ce qu’on leur dit en cours ne suffit pas : c’est la base qu’ils doivent connaître. Mais après, il y a tout un travail personnel à réaliser, des recherches à faire ». Autre point où le système éducatif a péché, « c’est leur orthographe, qui est calamiteuse. Et ça, dans notre discipline, dans nos métiers de l’écrit, c’est un vrai problème ! ». Quant à elle, la juriste s’est donnée comme mission principale, pour son mandat de cinq ans, de « les faire réussir, et assurer leur insertion professionnelle. C’est la mission de l’université, qui est un service public, et qui se doit d’avoir des formations performantes, attractives, qui répondent aux besoins du monde économique. Ma grande satisfaction, c’est qu’aujourd’hui, on a ici des taux d’insertion professionnelle de 93 %, même s’il faut encore que l’on se rapproche du 100 % ! Pour moi, l’étudiant qui sort de l’université sans diplôme, ou avec un diplôme qui ne lui servirait à rien, c’est un échec ».
Jonglant entre ses cours et les tâches administratives qui incombent à une présidente d’université, Corinne Mascala n’en oublie pas pour autant ses premières amours : le droit pénal des affaires, pour lequel elle consacre le mois de juillet à travailler pour une chronique annuelle sur le sujet publiée en septembre aux éditions Dalloz. Un domaine qui, alors qu’elle passait sa thèse, a reçu une nouvelle lumière à la faveur de l’affaire Urba à Marseille en 1989. « On connaissait déjà les pratiques de facturation » délictuelles, se souvient la spécialiste de la délinquance financière, « mais cette affaire a mis au jour toute une série de pratiques avec des entreprises qui surfacturaient, des sociétés fictives » ainsi que bien sûr, la corruption d’agents publics et le financement occulte du Parti socialiste. « Ce qui du coup posait la question : est-ce que le droit pénal est armé pour faire face à ce type de délit, ou faut-il prévoir de nouvelles incriminations ? Et à force de chercher, on finit par trouver ! Donc j’ai soutenu ma thèse à partir de dossiers concrets qui ont été le point de départ de ma réflexion sur quelle réponse pénale apporter à ces infractions, et comment les articuler – car dans ces dossiers, vous retrouvez de tout : escroquerie, faux en écriture, fraude fiscale… »
Trente ans plus tard, « il y a toujours une certaine indifférence pour la délinquance d’affaires, ce “crime sans victime”. La fraude fiscale, par exemple, interpelle peu : car beaucoup se disent qu’au final, la victime, c’est l’État. Par contre, quand quelqu’un est cambriolé ou assassiné, là, ça parle aux gens. Mais peu se rendent compte que l’État, c’est nous ! La fraude fiscale porte atteinte au portefeuille du contribuable, car moins il y a d’impôts qui rentrent, plus il y a de prélèvements. Cela dit, il y a des types d’infraction, comme le blanchiment de capitaux, qui sont difficiles à comprendre. On voit mal quelles conséquences cela peut avoir, alors que ça gangrène les économies au plan international ». D’où la nécessité, pour Corinne Mascala, de pousser « les magistrats à se spécialiser. Parce qu’avec cette délinquance de haut vol, il faut que, d’un bout à l’autre de la chaîne pénale, du policier au juge, il y ait des gens qui soient capables de démonter des montages financiers ou d’aller voir dans les paradis fiscaux… ». Car depuis l’affaire Urba, « les délits financiers se sont internationalisés. Pire, si, « il y a encore 10 ou 15 ans, la délinquance financière était encore l’affaire de chefs d’entreprise ou de commerçants, aujourd’hui, elle intéresse aussi les organisations criminelles. Les mafias, que l’on trouvait avant dans le proxénétisme ou le trafic de stupéfiants, ont désormais pour objectif de faire aussi du blanchiment de capitaux ou du délit d’initiés, parce que cela génère énormément de profits – et peut-être même plus que la délinquance classique ».
Fait amusant, si l’on ose dire, Corinne Mascala rappelle que l’État français lui-même a parfois fermé les yeux sur la corruption. « Quand je faisais ma thèse, j’ai travaillé sur une affaire qui concernait un marché entre la France et l’Espagne : un entrepreneur français travaillait dans le secteur des transports ferroviaires, et était en négociations avec l’Espagne pour y installer des voies ferrées. Or, pour avoir le marché, il fallait payer un pot-de-vin. Mais à l’époque, dans la loi de finances de 1988, il y avait un article qui admettait la déductibilité fiscale des pots-de-vin payés dans les contrats internationaux ! Autrement dit, l’État reconnaissait la corruption dans ce cas au prétexte que cela participait de l’activité économique… Donc lui aussi a participé à l’idée que, tant que c’était à l’étranger, c’était moins grave. Alors qu’aujourd’hui, la moralisation est des deux côtés, étatique comme entreprises, car c’est un outil de vitalité économique ».